|
|
|
|
|
|
|
|
Forum Opera, 29 Juillet 2016 |
| Par Sonia Hossein-Pour |
|
|
Cris et chuchotements
|
|
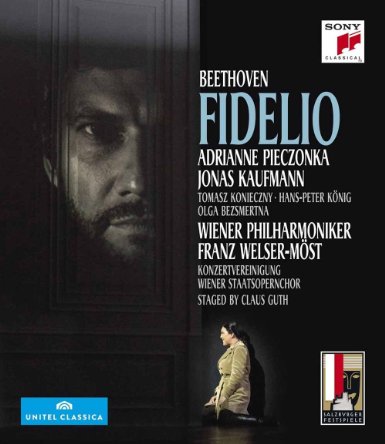 Habitué
du festival de Salzbourg où il a déjà monté plusieurs spectacles tels que la
trilogie Mozart/Da Ponte à la fin des années 2000, le metteur en scène
allemand Claus Guth y est revenu en 2015 avec Fidelio, l’unique opéra
maintes fois remanié de Beethoven. Cherchant à en percer les mystères à la
manière d’une exégèse psychanalytique, il montre une nouvelle fois que le
théâtre et l’opéra sont pour lui des lieux de recherche, d’une inépuisable
et nécessaire expérimentation. Habitué
du festival de Salzbourg où il a déjà monté plusieurs spectacles tels que la
trilogie Mozart/Da Ponte à la fin des années 2000, le metteur en scène
allemand Claus Guth y est revenu en 2015 avec Fidelio, l’unique opéra
maintes fois remanié de Beethoven. Cherchant à en percer les mystères à la
manière d’une exégèse psychanalytique, il montre une nouvelle fois que le
théâtre et l’opéra sont pour lui des lieux de recherche, d’une inépuisable
et nécessaire expérimentation.
Toute l’action se produit ici dans un
lieu unique, presque sans décor, si ce n’est ce grand bloc noir et lisse
autour duquel gravitent les personnages de cette histoire d’amour
singulière. Fidelio est ici accompagné(e) de son double féminin – selon un
procédé déjà employé par le metteur en scène –, lequel s’exprime en langage
des signes, quand les autres personnages voient leurs ombres projetées
contre les murs blancs qui enceignent l’espace. Dans ce « Je est un autre »
rimbaldien, Guth cherche à sonder et à exhiber la dualité intérieure des
personnages : là où l’ambivalence est de prime abord sexuelle, il s’agit
d’en révéler cette fois-ci la dimension psychologique. Pour la souligner,
des bribes de sons et de chuchotements se font entendre entre deux scènes,
simulant les méandres de l’inconscient. L’espace scénique est ainsi le lieu
privilégié de leurs pérégrinations mentales, mais Guth ne cherche pas à en
faire surgir une quelconque vérité. Ces bruits, cette langue des signes,
rien ou presque n’en est intelligible ; simplement, il veut montrer que ce
trouble intérieur existe. La fin de l’opéra, où, après de glorieuses
retrouvailles, Florestan s’écroule (de fatigue ? de maladie ?) relate ici
encore cette extrême ambivalence.
Pour intéressante que soit cette
proposition scénique, il n’en reste pas moins qu’elle montre ses limites
d’un point de vue théâtral, et le risque demeure que ces intermèdes sonores
réguliers disloquent l’œuvre au détriment de sa cohérence et de son unité.
Malgré une direction d’acteurs satisfaisante, certains personnages donnent
l’impression d’être livrés à eux-mêmes : ainsi du Florestan de Jonas
Kaufmann qui n’est pas loin de sur-jouer, dans ses hasardeux va-et-vient le
long du proscenium, au moment de son air d’entrée « Gott ! Welch’ dunkeln
hier ». Et l’émotion s’en ressent, même si, vocalement, ce rôle maintes fois
interprété par le ténor allemand est d’une incontestable maîtrise. Alors que
Christa Ludwig trône sur l'autel sacré de nos interprétations de
prédilection, Adrienne Pieczonka apparaît comme un Fidelio extrêmement
charismatique, plein d’une vénérable dignité et souveraine dans la longueur
de la tessiture. Sans doute est-elle trop hommasse toutefois, si bien que
les deux entités du couple se marient fort peu, et le parti-pris de la mise
en scène achève par ailleurs d’ôter tout sentimentalisme qui aurait donné un
tant soit peu de chaleur entre eux, comme si l’on ne gardait de romantique
que l’intention. Malgré la sobriété de la mise en scène, le duo
Marzelline/Jaquino demeure subtilement dans le ton farcesque du singspiel.
Olga Bezsmertna n’a pas le timbre ni le vibrato des plus séduisants mais
elle fait une Marzelline tout à fait convaincante, et dans les yeux de qui
luit sournoisement un brin de charme et de malice. Dans la même veine,
Jaquino, son soupirant, est excellemment interprété par Norbert Ernst. Belle
profondeur de voix pour le Rocco de Hans-Peter König ainsi que le Don
Fernando de Sebastien Holecek. Le Don Pizarro de Tomasz Konieczny n’a enfin
rien perdu ici de sa méchanceté originelle et consubstantielle, affublé
comme l’un de ces hackers du Matrix des frère et sœur Lachowski.
Sous
la direction de Franz Welser-Möst, les Wiener Philharmoniker et
Staatsopernchor feraient aisément oublier l’indigence orchestrale de la
partition beethovénienne décriée par certains, tant leur sonorité
symphonique, pléthorique, inonde l’espace avec faste, comblant d’un fabuleux
décor sonore les vides persistants de la scénographie.
On regrettera
l’absence de bonus ainsi qu’un livret peu disert et sans aucune mise en
perspective du projet du metteur en scène. Mais on louera la réalisation de
Michael Beyer, élégante, inventive, avec ce qu’il faut d’équilibre entre
plans rapprochés et généraux, et qui fait pourtant défaut dans la plupart
des captations.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|