|
|
|
|
|
|
|
|
Classica, 20 décembre 2021 |
|
Par Pierre Flinois |
|
|
|
|
La conquête de « la ville »
|
|
|
|
|
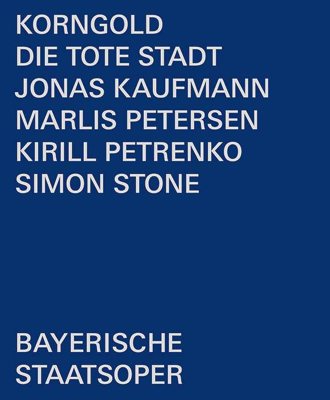 Le
chef-d’œuvre de Korngold a fait un retour éclatant à l’Opéra de Munich.
Avec la voix sacrée de Jonas Kaufmann sur scène et l’architecte des sons
Kirill Petrenko dans la fosse, La Ville morte est entre de bonnes mains. Le
chef-d’œuvre de Korngold a fait un retour éclatant à l’Opéra de Munich.
Avec la voix sacrée de Jonas Kaufmann sur scène et l’architecte des sons
Kirill Petrenko dans la fosse, La Ville morte est entre de bonnes mains.
N’attendez pas de Simon Stone, le metteur en scène de La Traviata à
Garnier, qu’il montre le symbolisme fin XIXe siècle suintant de
Bruges-la-Morte de Georges Rodenbach, même si Korngold y trouva
l’inspiration de son chef-d’œuvre. Pas de vieille demeure enténébrée,
pas de quai romantique, de célébration religieuse… C’est dans un
pavillon blanc moderniste, façon De Stijl, que se passe un premier
tableau réaliste où la vie a été emballée, recouverte, autour d’un
sanctuaire de polaroids préservant la chevelure révérée de Marie, la
morte, qui, sitôt après sa si perturbante réincarnation en Marietta
sortie de son mausolée, viendra, en phase terminale de ce qui l’a
emportée naguère, rappeler le poids d’un amour ancien. Par la grâce de
la scène tournante, demeure et esprit de Paul explosent vers tous les
possibles d’une analyse psychologique du délabrement mental, fait de
tensions, de sensualité, de sexualité (l’affiche du Blow-Up d’Antonioni
n’est pas là pour rien, pas plus que celle de Pierrot le Fou), de refus
de la réalité, où le jeu des multiples de Paul, Marie, Marietta expose
l’angoisse d’un cauchemar dont la conclusion violente sera cathartique.
Rien qui soit là hors sujet, sinon ce refus d’ambiance morbide dont
Stone préfère exposer la réalité façon divan freudien, plutôt que le
décoratif, estimant que la musique suffit à installer là où il convient
le post-romantisme exalté et pernicieux.
Dans la fosse, Kirill
Petrenko refuse l’emphase et le risque d’excès d’une orchestration
surdimensionnée, mais irrésistiblement séduisante, dont il fait
ressortir d’abord les transparences, les clartés, les finesses, le sens
des couleurs exploité à foison, et la construction dramatique,
architecturant comme jamais l’introduction à l’acte II, ou la lutte
entre Marietta et Paul au troisième tableau ; tout en se faisant le
plaisir d’exposer la somme des influences du compositeur de 20 ans,
capable d’en faire un style personnel malgré tout. Où précédemment
a-t-on entendu ainsi les cloches sonner comme dans Parsifal, les cordes
caresser comme dans Le Chevalier, les chœurs renvoyer si ouvertement à
Butterfly ? L’orchestre est bien entendu absolu, et subjugué par son
chef.
L’atout Kaufmann
Les voix n’ont alors qu’à y
installer leur beauté et leur sens du théâtre. On peut attendre pour
Marietta/Marie un timbre plus corsé, plus dramatique, mais on reconnaît
à Marlis Petersen, somptueuse Lulu, Salomé enflammée, malgré un grave
sans grand rayonnement – qui réduit un peu le plaisir de « Glück, das
mir verblieb » –, un aigu virtuose, une maîtrise de la ligne parfaite et
une présence physique qui explose encore plus à l’écran, en véritable
actrice moderne qu’elle est. Même engagement du corps, un peu plus lourd
que naguère, avec sa cinquantaine bien portée, et jeu d’expression d’une
mobilité stupéfiante chez Jonas Kaufmann. Et forme vocale supérieure,
d’une franchise absolue, qui ne cherche pas à cacher quelques aigus un
rien tendus, et pratique à l’envi demi-teintes, sons filés, tenus
exceptionnels, forçant, comme Petrenko, à la nuance et à la subtilité
l’éprouvante tessiture de Paul. Si le Frank d’Andrzej Filonczyk manque
un peu de charisme, il est délicieux en Fritz (« Mein Sehnen »), bien
qu’outrageusement maquillé en rocker décati. Et Jennifer Johnston, le
délicieux Victorin de Manuel Günther, les chœurs, tous font référence.
Une vraie réussite qui l’emporte sur les quatre versions filmées
existantes. Notez que cette Ville morte est le premier opus vidéo en
autoédition de la Staatsoper, qui, concernant Petrenko, dort sur un
formidable trésor. Espérons une suite!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|