|
|
|
|
|
|
|
|
Diapason, mai 2014 |
|
Emmanuel Dupuy |
|
|
Jonaaaaaas !!!
|
|
Diapason d'or |
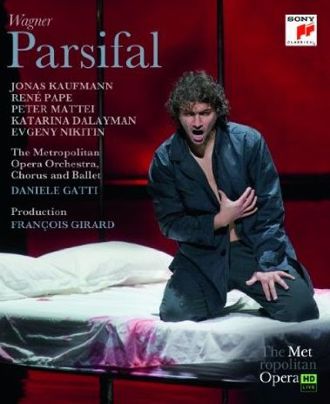 Mais
où s'arrêtera-t-il ? Dans le Faust de Gounod ou lors d'un
concert Wagner, Jonas Kaufmann apporte une fois encore la preuve
de son génie vocal. Et au Met, serti par un spectacle
visuellement parfait, il impose un des plus grands Parsifal...
de tous les temps. Mais
où s'arrêtera-t-il ? Dans le Faust de Gounod ou lors d'un
concert Wagner, Jonas Kaufmann apporte une fois encore la preuve
de son génie vocal. Et au Met, serti par un spectacle
visuellement parfait, il impose un des plus grands Parsifal...
de tous les temps.
Il arrive qu'un spectacle
soit transcendé par l'interprétation musicale. C'est le cas de
ce Parsifal que nous avions vu à Lyon avec une autre
distribution, un autre chef et un autre orchestre, et dont la
logique avant tout illustrative nous avait semblé quelque peu
réductrice, après la lecture si stimulante d'un Romeo
Castellucci (Monnaie de Bruxelles, DVD BelAir, cf n° 619).
Oui, mais voilà : pour la reprise new-yorkaise, on a réuni
un cast inespéré, et soudain, le beau livre d'images ouvert par
François Girard prend tout son sens — d'autant qu'il se révèle
des plus télégéniques, Girard n'étant pas pour rien cinéaste.
Superbe décor volcanique (signé Michael Levine), au milieu
duquel coule une source bienfaitrice à l'acte I, puis une
rivière de sang au II, ciels alla Véronèse, paysages cosmiques
au III, gestique millimétrée : tout concourt à la réalisation
d'un projet visuel parfaitement léché, qui rend au propos une
lisibilité sans ombre (ce n'est pas si fréquent), tout en
laissant la primauté au chant.
Et quel chant ! Le
Parsifal de Kaufmann s'inscrit d'ores et déjà dans l'Histoire
(la majuscule n'est pas de trop), incarnation idéale, tant
physique que musicale, soleil noir resplendissant d'une infinie
variété d'accents, de nuances et de phrasés à se damner. On a
beau remonter très loin dans la discographie, on n'a pas
souvenir d'avoir entendu un « Amfortas die Wunde » chanté et
vécu avec une telle plénitude. Rien que pour ces quelques
minutes d'extase : à genoux !
A genoux aussi devant
l'Amfortas de Mattei, lové dans le velours de son baryton
glorieux, identifié corps, voix et âme au personnage, faisant
vibrer, au tréfonds de lui-même, les mille cordes sensibles
d'une plainte à fendre le coeur. Là encore, c'est historique. Et
Pape n'est pas en reste, car s'il ne possède pas vraiment le
grave abyssal des plus grands Gurnemanz, il en a l'endurance, la
vaillance encore jeune, l'extrême précision des mots et cet art
inné des caresses compassionnelles. Nikitin crache le poison de
Klingsor avec toute la santé de son insolent baryton. Et
Dalayman, bien qu'elle ne distille pas les séductions venimeuses
qui font les plus inoubliables Kundry, met beaucoup d'ardeur à
expier ses fautes, soprano à la fois athlétique et blessé, comme
vaincue d'avance par les puissances mystiques qu'elle affronte.
La direction de Gatti est un peu à l'image du spectacle :
bien rodée, sans baisse de tension, claire. Ne cherchons pas
dans les lenteurs du I (et ses quelques approximations) les
abîmes métaphysiques qu'y ouvrait un Knappertsbusch. Le II file
avec davantage de prestance, plutôt dans la lignée d'un Boulez —
mais sans ses fulgurances, certes. C'est au III que cette
lecture atteint sa pleine mesure, souple, spontanée, passant en
un seul geste des atmosphères désolées à la plus vive lumière
rédemptrice. Et chaque pupitre du Met se couvre de gloire,
offrant tout un arc-en-ciel de grâces instrumentales tapies dans
la masse d'une matière somptueuse.
Ce n'est peut-être
pas, en DVD, le Parsifal qui vous fera le plus réfléchir (pour
cela recherchez sur le Net le film étrange de Syberberg, ou
tentez l'expérience Castellucci). Mais c'est sans conteste le
plus hédoniste, celui qui possède la plus haute somme de
qualités, apothéose du chant, de la musique, de l'image. Vous
avez dit art total ?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|