|
|
|
|
|
|
|
| ClassiqueInfo-disque, 21
novembre 2008 |
| Pierre Brévignon |
|
|
Carmen à Covent Garden : deux bêtes de scène au service
d’une vision malheureusement un peu trop sage…
|
| Ceux qui avaient assisté aux représentations
de Carmen à Covent Garden fin 2006 en parlaient avec des sanglots dans la
voix, et nous assuraient qu’avec ce duo Antonacci-Kaufmann le nouveau couple
glamour de la scène lyrique internationale était né – un titre jusqu’alors
trusté par les Alagna-Gheorgiu et autre Netrebko-Villazon. Decca vient nous
offrir, en cette veille de fêtes, l’occasion de juger sur pièces. |
|
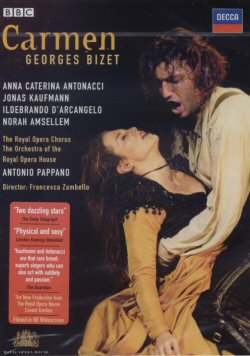 Autant
ne pas en faire mystère : la rumeur flatteuse qui précède la sortie de ce
DVD n’est en rien usurpée, tant la qualité principale de cette Carmen
londonienne réside effectivement dans son couple vedette qui « crève la
scène » comme on dit des stars de cinéma qu’elles crèvent l’écran. Avec,
cette fois, une valeur ajoutée un brin perverse fondée sur la dissemblance
physique entre cette Carmen-ci et ce Don José-là. Car, indépendamment de
leurs qualités vocales, éclatantes dès leurs premiers échanges (mais surtout
éclatantes de naturel), c’est bien à travers leur opposition corporelle que
se joue l’affrontement subtil entre la pulpeuse maturité d’Anna Caterina
Antonacci et un Jonas Kaufmann dont la silhouette longiligne et les traits
juvéniles paraissent d’emblée ne pas faire le poids. Le jeu d’acteur réglé
par Francesca Zambello exploite au mieux ce contraste : Carmen arpente la
scène avec la nonchalance dévoreuse d’une prédatrice un peu lasse, habituée
à se jouer des hommes, circonscrivant un Don José encombré de son propre
corps, réduit le plus souvent au statisme ou à la posture assise – une
proie, déjà, broyée un peu plus à chaque acte jusqu’à abdiquer toute dignité
pour se transformer en un meurtrier pathétique. Autant
ne pas en faire mystère : la rumeur flatteuse qui précède la sortie de ce
DVD n’est en rien usurpée, tant la qualité principale de cette Carmen
londonienne réside effectivement dans son couple vedette qui « crève la
scène » comme on dit des stars de cinéma qu’elles crèvent l’écran. Avec,
cette fois, une valeur ajoutée un brin perverse fondée sur la dissemblance
physique entre cette Carmen-ci et ce Don José-là. Car, indépendamment de
leurs qualités vocales, éclatantes dès leurs premiers échanges (mais surtout
éclatantes de naturel), c’est bien à travers leur opposition corporelle que
se joue l’affrontement subtil entre la pulpeuse maturité d’Anna Caterina
Antonacci et un Jonas Kaufmann dont la silhouette longiligne et les traits
juvéniles paraissent d’emblée ne pas faire le poids. Le jeu d’acteur réglé
par Francesca Zambello exploite au mieux ce contraste : Carmen arpente la
scène avec la nonchalance dévoreuse d’une prédatrice un peu lasse, habituée
à se jouer des hommes, circonscrivant un Don José encombré de son propre
corps, réduit le plus souvent au statisme ou à la posture assise – une
proie, déjà, broyée un peu plus à chaque acte jusqu’à abdiquer toute dignité
pour se transformer en un meurtrier pathétique.
Un bonheur n’arrivant jamais seul, ces deux tempéraments d’acteurs – à
tendance parfois outrancière chez Kaufmann, que quelques gros plans
importuns viennent surprendre en flagrant délit de mimique expressionniste
sursignifiante - s’incarnent aussi dans une vocalità enthousiasmante.
Rarement on aura à ce point assisté à la fusion du drame dans le chant, de
sorte que le flux de paroles des séquences dialoguées vers les séquences
lyriques semble s’inscrire dans la même continuité théâtrale – le tout dans
un français à la prononciation irréprochable, sans jamais forcer
l’articulation. La voix rauque d’Antonacci laisse entrevoir ce qu’il faut de
failles pour donner de la densité à son personnage, mais la splendeur
absolue reste la performance vocale de Kaufmann. Chacune de ses
interventions est l’occasion de déployer une palette de nuances maîtrisée à
la perfection, osant des pianissimi d’une texture presque chambriste, avec
une apparence de simplicité qui laisse admiratif. Les réussites les plus
marquantes à cet égard sont sans doute son magnifique duo avec Micaëla à
l’Acte I (le long silence qui accueille la fin de l’air en dit long sur
l’intensité de ce moment) et l’Air de la Fleur de l’Acte II, où Kaufmann dit
son émotion avec une sensibilité de grand chanteur de récital. À l’autre
extrémité du spectre, la voix du ténor se mue en cri dans le Finale, d’une
sauvagerie et d’une nudité portées à l’incandescence par la baguette
inspirée de Pappano – et tant pis s’il a fallu attendre ce dernier acte pour
entendre s’emballer le jusqu’alors trop sage orchestre de Covent Garden.
Ajoutons que le reste de la distribution mérite également tous les éloges,
avec un Ildebrando D’Arcangelo superbe d’arrogance vocale mais capable,
aussi, de laisser percer une humanité dont ce personnage est d’habitude peu
coutumier, une Norah Amsellem qui émeut sans minauder et un couple
Remendado/Dancaïre que le talent de Jean-Paul Fouchécourt et Jean-Sébastien
Bou suffit à faire exister en deux répliques. Nos seules réserves porteront
sur la captation proposée par Jonathan Haswell. Dans cette œuvre où les
scènes de groupe abondent, le réalisateur s’ingénie à morceler des gestes
qu’on aurait aimé saisir dans un contexte plus large. Tout l’Acte I en
souffre, plongé dans une semi-pénombre censément menaçante (le Fatum est, il
est vrai, proclamé dès l’Ouverture par une pantomime assez maladroite
montrant Don José aux mains de son geôlier), mais qui plombe surtout les
mouvements de foule et les saynètes qui s’y déroulent. Même problème avec la
Chanson Bohème qui ouvre l’Acte II (la chorégraphie orgiaque d’Arthur Pita
méritait pourtant qu’on s’y attarde) ou l’air des Cartes de l’Acte III, que
la caméra semble avoir du mal à suivre. Par chance, la réalisation parvient
à rendre justice au splendide décor du campement des contrebandiers, tout en
feu et poussière, et à l’espace quasi abstrait de l’Acte IV, qui inscrit le
Finale dans les arènes claustrophobes d’un Francis Bacon où, sol y sombre,
se célèbrent les noces de l’amour et de la mort. Cet été à Zurich, dans une
mise en scène aux options radicalement opposées à celles de Francesca
Zambello, Jonas Kaufmann endossait à nouveau les habits de Don José et
s’imposait avec brio. On est désormais curieux de découvrir, au printemps
2009, Anna Caterina Antonacci dans une Carmen emmenée par John Eliot
Gardiner et l’Orchestre révolutionnaire et romantique sous les ors de
l’Opéra-Comique. Rendez-vous est pris ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|