|
|
|
|
|
|
|
|
Anaclase |
|
par laurent bergnach |
|
|
Adriana Lecouvreur | Adrienne Lecouvreur
|
|
|
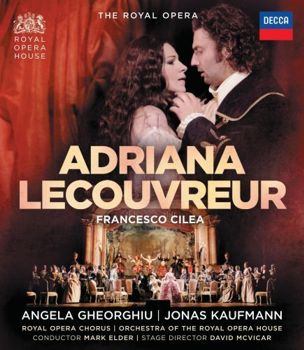 Dans
une Italie qui cherche un successeur à Verdi comme symbole de l’identité
musicale, porté par la rivalité qui oppose son éditeur Sonzogno à Ricordi,
Francesco Cilea (1866-1950) apparaît comme un favori au sein de la giovane
scuola, cette nouvelle génération qui regroupe les talents variés de
Catalani (né en 1854), Leoncavallo (1857), Puccini (1858), Franchetti (1860)
ou encore Mascagni (1863). Chacun le sait aujourd’hui : même si l’on compare
l’échec de la première version de Madama Butterfly à la Scala de Milan,
début 1904, au succès que fut la création d’Adriana Lecouvreur à la
Cannobiana de cette même ville, le 6 novembre 1902, celui qui s’empare du
trône laissé vacant depuis Falstaff (1893) n’est pas celui qu’on attendait… Dans
une Italie qui cherche un successeur à Verdi comme symbole de l’identité
musicale, porté par la rivalité qui oppose son éditeur Sonzogno à Ricordi,
Francesco Cilea (1866-1950) apparaît comme un favori au sein de la giovane
scuola, cette nouvelle génération qui regroupe les talents variés de
Catalani (né en 1854), Leoncavallo (1857), Puccini (1858), Franchetti (1860)
ou encore Mascagni (1863). Chacun le sait aujourd’hui : même si l’on compare
l’échec de la première version de Madama Butterfly à la Scala de Milan,
début 1904, au succès que fut la création d’Adriana Lecouvreur à la
Cannobiana de cette même ville, le 6 novembre 1902, celui qui s’empare du
trône laissé vacant depuis Falstaff (1893) n’est pas celui qu’on attendait…
Pour romancer la véritable liaison de l’actrice de la Comédie-France
(1692-1730) et du comte Maurice de Saxe (1696-1750), l’auteur de L’Arlesiana
(1897) use d’un livret d’Arturo Colautti inspiré d’une pièce de Scribe et
Legouvé et d’un lyrisme romantique hérité du XIXe siècle. Comme l’écrit John
Snelson dans la brochure d’accompagnement : « C’est une histoire réalisée en
termes théâtraux, où des accessoires comme des lettres prennent une
signification dans la vie réelle, où les identités sont cachées ou
délibérément embrouillées. C’est un monde où les coïncidences, les bonds de
l’imagination et les réactions extrêmes sont des qualités non seulement
acceptables, mais déterminantes au service d’une vérité différente,
émotionnelle. Il confronte le public à une vision du théâtre lui-même ».
Malheureusement, l’ouvrage n’a plus vraiment les faveurs des
programmations. À Londres, par exemple, où la production de la Royal Opera
House nous emmène en cet hiver 2010 (22 novembre et 4 décembre), il n’avait
pas été vu depuis 1906 ! Drôle, émouvante autant qu’attachée à entretenir le
suspense de cette histoire d’amour, de jalousie et de mort, la vision de
David McVicar favorise une renaissance tout en finesse. Les décors de
Charles Edwards, attachés à la vérité historique sans étouffer les
protagonistes, contribuent amplement à cette réflexion sur artifice et
réalité – laquelle est filmée avec soin et variété, et assortie d’un bonus
d’une vingtaine de minutes.
À la création, la présence d’Enrico
Caruso et d’Angelica Pandolfini avait contribué à l’engouement du public.
Aujourd’hui dans le rôle-titre, Angela Gheorghiu souffle le chaud et le
froid. La dolcissima efigie, son air initial, est un modèle de malhonnêteté
pour lequel le soprano s’économise et déclenche les applaudissements avec
d’ultimes notes racoleuses. Le chant est tout d’abord maniéré et
précautionneux pour gagner en onctuosité. En revanche, le jeu continue
d’être décevant – extériorité, bouderie, minauderie –, sauf pour le
monologue de Phèdre où l’artiste se montre une tragédienne expressive
inattendue. Nulle mauvaise surprise avec Jonas Kaufmann (Maurizio),
ténor vaillant qui offre une gamme plus large que ses seuls aigus, avec un
chant nuancé et un timbre chaud.
Le reste de la distribution
vocale est efficace, avec en tête Olga Borodina, offrant ampleur, plénitude
et générosité à la Princesse de Bouillon, et Alessandro Corbelli
(Michonnet), crédible à plus d’un titre. Si Maurizio Muraro (Prince de
Bouillon) est flanqué du décevant Bonaventura Bottone (Abbé de Chazeuil à
côté de ses notes), Iain Paton (Poisson), David Soar (Quinault), Janis Kelly
(Mlle Jouvenot) et Sarah Castle (Mlle Dangeville) forment un ensemble
homogène et attachant. Enfin, à la tête de l’orchestre maison, Mark Elder se
montre alerte (Ouverture) ou, au contraire, d’une tendresse extrême (prélude
de l’Acte IV) ; il fait sonner au mieux alliages pucciniens et wagnérismes,
et sublime la musique dans la pastorale bouffe de l’Acte III (Le jugement de
Paris), chorégraphiée par Andrew George.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|